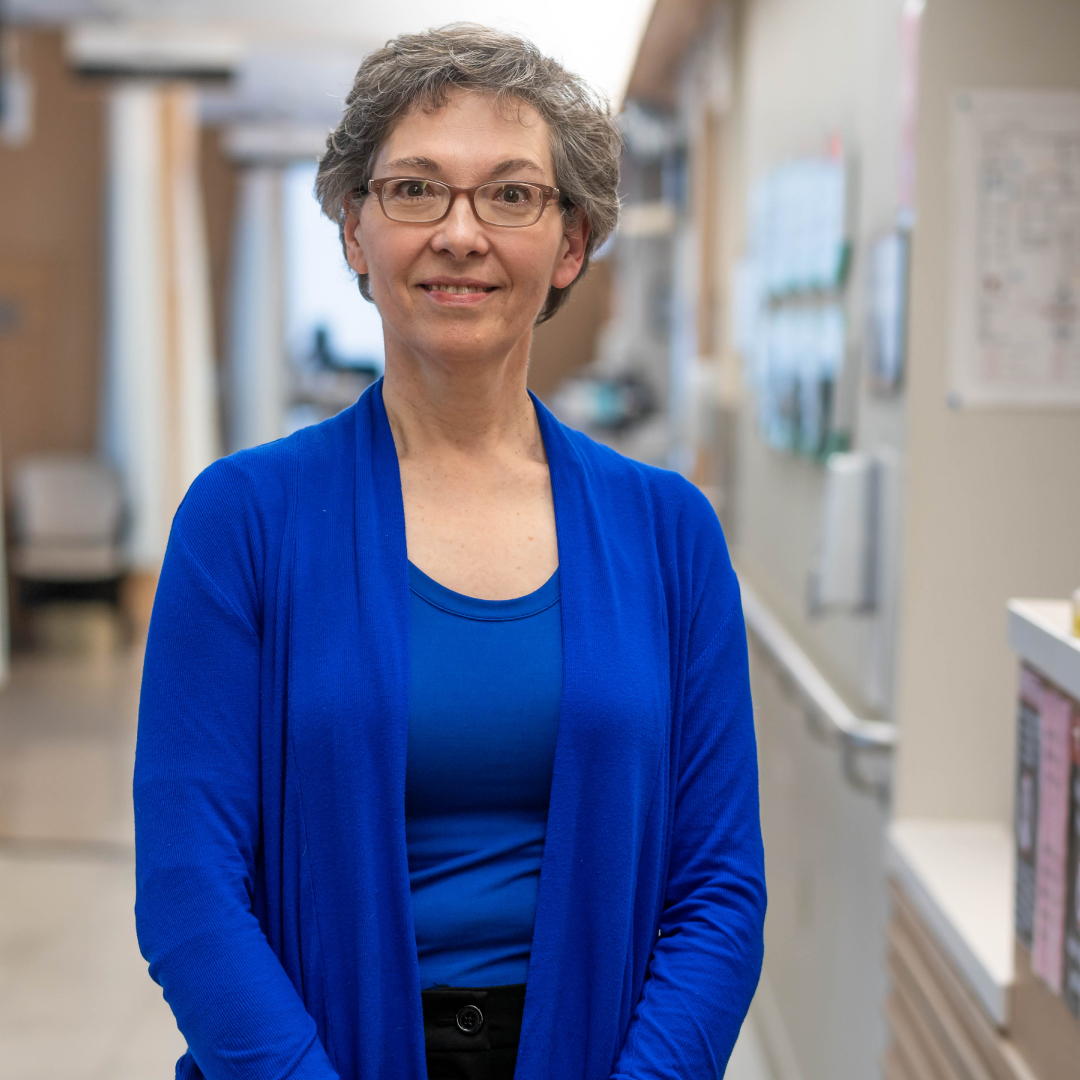Au début de sa carrière au milieu des années 1990, le Dr Tien Le était le seul gynécologue oncologue dans toute la province de la Saskatchewan. Aujourd’hui, il est l’un des 40 gynécologues oncologues de l’Ontario qui refaçonnent les soins oncogynécologiques. Le Dr Tien Le, gynécologue oncologue et chercheur à l’Hôpital d’Ottawa qui partage son temps entre la prestation de soins aux patients et la réalisation de recherches axées sur l’innovation pratique, est arrivé à Ottawa en 2002 pour se joindre à une équipe d’oncologie pluridisciplinaire dynamique déterminée à offrir des soins longitudinaux de pointe aux femmes atteintes d’une forme ou d’une autre de cancer gynécologique.
Découvrez comment le domaine de l’oncogynécologie a radicalement changé depuis les débuts du Dr Le dans cette discipline, et ce qui l’enthousiasme le plus aujourd’hui.
Q : À quoi a ressemblé votre jeunesse?
R : J’ai grandi à Ottawa, mais à l’origine, j’ai émigré du Vietnam en tant que « réfugié de la mer » quand j’avais cinq ans. J’ai fréquenté le Glebe Collegiate Institute, où la science était mon sujet préféré. J’ai toujours été attiré par la physiologie et cherché à comprendre comment les choses fonctionnent.
En dehors des cours, je consacrais la majeure partie de mon temps à l’écriture de codes pour des jeux d’ordinateur et à l’apprentissage de l’informatique. À l’époque, nous avions encore accès à Internet par ligne commutée. Le codage vous aide à réfléchir aux problèmes en considérant systématiquement chacune des étapes et à les résoudre en faisant appel à la logique. Le fait d’apprendre à appliquer cette méthode au travail que j’accomplis aujourd’hui s’est avéré très productif et gratifiant. J’ai effectué une grande partie de mes propres analyses de données et statistiques lorsque j’ai étudié en épidémiologie et en biostatistique après mon programme de bourse de recherche.
Q : Comment avez-vous décidé de poursuivre une carrière en médecine?
R : Au Vietnam, mon père était ophtalmologiste, mais lorsque nous avons déménagé ici, il a travaillé comme médecin de famille. J’ai donc été exposé à la médecine dès mon enfance.
Lorsque j’ai fait ma demande d’admission à l’université, je savais que je voulais œuvrer dans les soins de santé, mais la médecine n’était pas encore au sommet de ma liste parce qu’il y avait beaucoup d’autres choses qui suscitaient mon intérêt. J’ai fait mes études de premier cycle en biochimie et en physiologie à l’Université d’Ottawa et, à l’époque, j’envisageais une carrière en recherche ou en dentisterie. Toutefois, au cours de ma première année universitaire, je me suis intéressé de plus en plus à la physiologie et à l’anatomie, et à la façon dont les différents systèmes d’organes interagissent chez les personnes en santé et chez les personnes malades. En fin de compte, c’est le désir d’appliquer ces connaissances à la gestion des soins thérapeutiques qui l’a emporté. J’en suis arrivé à la conclusion que la médecine constituait la meilleure voie à suivre, et j’ai été accepté à l’école de médecine de l’Université de Toronto après seulement deux années d’études de premier cycle.
Q : Qu’est-ce qui vous a attiré vers l’oncogynécologie en particulier?
R : Pendant mes études de médecine, la santé des femmes était une spécialité relativement négligée. J’y ai vu beaucoup de possibilités de recherche et d’épanouissement personnel. J’ai fait ma résidence en obstétrique et en gynécologie à l’Université du Manitoba, et cet établissement avait un programme d’oncogynécologie bien établi. Le directeur du programme, le Dr Garry Krepart, était l’un des fondateurs de cette spécialité de la médecine gynécologique au Canada. Je me suis intéressé de plus en plus à ce domaine au fil de ma résidence parce que c’était le mariage parfait entre l’oncologie chirurgicale et l’oncologie médicale, ce qui est unique à cette spécialité.
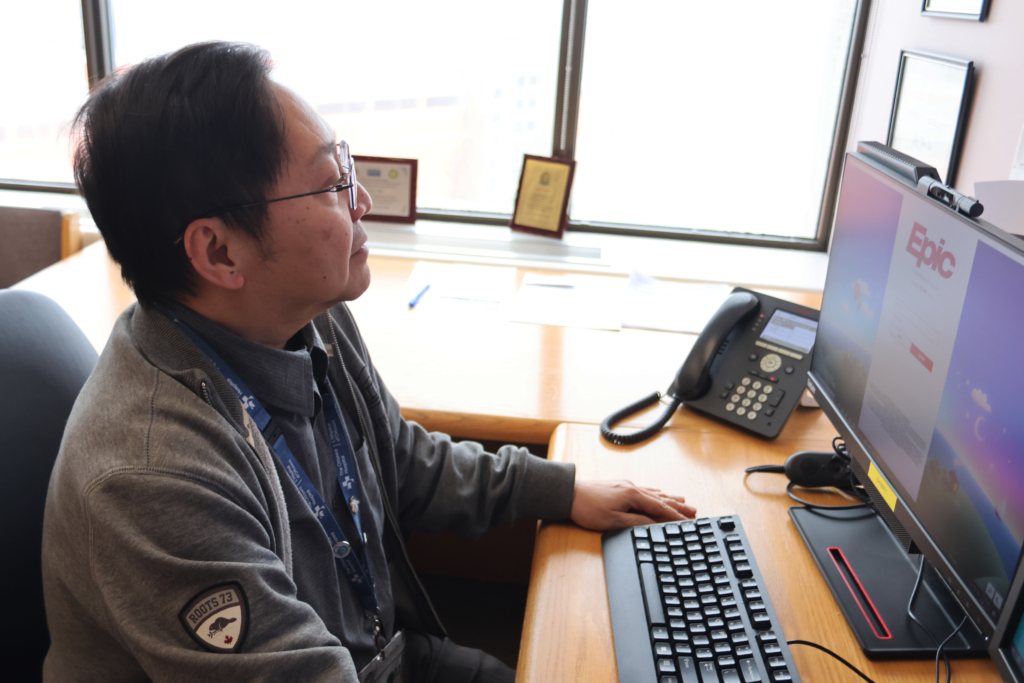
Q : En quoi le domaine de l’oncogynécologie a-t-il changé depuis vos débuts dans celui-ci?
« Les patientes continuent de vivre plus longtemps et d’avoir une meilleure qualité de vie ».
— Dr Tien Le
R : Le domaine progresse très rapidement, et de grandes avancées ont été réalisées depuis la fin de mes études de médecine. Par exemple, à l’époque où j’étais étudiant, le temps moyen de survie d’une patiente atteinte d’un cancer de l’ovaire à un stade avancé était de moins de 12 mois. Pendant ma résidence, le temps moyen de survie est passé à deux ans. Il est aujourd’hui de cinq ans, et les patientes continuent de vivre plus longtemps et d’avoir une meilleure qualité de vie grâce aux nouvelles thérapies ciblées et aux approches thérapeutiques novatrices. Tout cela peut être attribué à de meilleures stratégies thérapeutiques, ce qui comprend la chirurgie, la chimiothérapie et le recours à la thérapie d’entretien. Par exemple, dans le cas du cancer de l’ovaire, l’utilisation d’inhibiteurs de PARP (sous forme de comprimés oraux appelés olaparib et niraparib) pour faire en sorte que le cancer demeure en rémission est maintenant couramment recommandée.
Lorsqu’il s’agit du cancer de l’ovaire, bien que les oncologues aient eu beaucoup de succès pour ce qui est d’en arriver à une phase de rémission après un traitement primaire, la plupart des patientes atteintes d’un cancer à un stade avancé verront celui-ci réapparaître. De plus en plus, nous considérons le cancer de l’ovaire comme une maladie chronique qui, à l’instar du diabète ou de l’asthme, peut être gérée au moyen de traitements efficaces.
Q : Quel est le secteur de recherche le plus enthousiasmant à l’heure actuelle dans votre domaine?
R : Les essais cliniques constituent un élément essentiel de toute pratique oncologique parce qu’ils nous permettent de déterminer les thérapies les plus efficaces et d’offrir les traitements les plus avancés pour des cancers particuliers. À L’Hôpital d’Ottawa, nous menons actuellement un certain nombre d’essais sur les cancers de l’ovaire, de l’utérus et du col de l’utérus.
En ce qui concerne le cancer de l’ovaire, nous étudions une nouvelle catégorie de médicaments appelés « conjugués anticorps-médicament » ou CAM. Les CAM sont composés d’un anticorps lié à un médicament actif toxique pour les cellules cancéreuses. C’est comme un projectile magique ou un cheval de Troie : le médicament n’est absorbé que par les cellules cancéreuses, les cellules normales n’étant pas touchées.
L’autre thérapie qui suscite beaucoup d’enthousiasme au sein de la communauté des gynécologues oncologues est l’immunothérapie pour le traitement des cancers de l’utérus et du col de l’utérus. Elle fonctionne très différemment de la chimiothérapie traditionnelle, en ce sens que l’immunothérapie est utilisée pour stimuler le système immunitaire de la patiente de manière à ce qu’il repère et détruise les cellules cancéreuses. Elle s’est avérée très efficace, et nous l’employons régulièrement pour traiter les cancers métastatiques de l’utérus et du col de l’utérus à un stade avancé.
Enfin, une autre thérapie que nous utilisons à L’Hôpital d’Ottawa est la chimiothérapie hyperthermique intrapéritonéale (CHIP). Dans le cadre du traitement, nous administrons une solution de chimiothérapie chauffée dans la cavité abdominale pendant la chirurgie. Il a été démontré que cela prolonge la survie des patientes atteintes d’un cancer de l’ovaire. L’Hôpital d’Ottawa est seulement le deuxième établissement de l’Ontario à offrir ce traitement.
Q : Vous avez travaillé sur le cas de Jennifer Hollington. En quoi celui-ci était-il unique en son genre?
R : Le cas de Jennifer illustre parfaitement la manière dont fonctionne notre modèle longitudinal et multidisciplinaire de prestation de soins. Elle a d’abord reçu un diagnostic de masse pelvienne importante, et son gynécologue l’a aiguillée vers notre équipe d’oncogynécologie au Campus Général. C’est à moi qu’est revenue la responsabilité de pratiquer l’intervention. Jennifer a par la suite suivi un traitement de chimiothérapie et a reçu le soutien de notre équipe élargie d’infirmières, de pharmaciens, de résidents, de boursiers et de professionnels paramédicaux pendant son parcours contre le cancer.
Après que des tests génétiques eurent révélé que Jennifer était porteuse du gène BRCA2, ce qui augmente le risque de cancers de l’ovaire et du sein, elle a décidé de subir une mastectomie préventive. Ces connaissances ont également contribué à orienter le traitement relatif à son cancer de l’ovaire. L’olaparib est particulièrement efficace chez les personnes porteuses du gène BRCA2. Nous avons commencé le traitement avec cette stratégie de thérapie d’entretien personnalisée fondée sur le profil de la tumeur.
Jennifer avait également un mélanome, ce qui était une malheureuse coïncidence, et notre équipe de soins l’a soutenue tout au long de cette période.
Il faut garder à l’esprit que le cancer de l’ovaire est relativement rare comparativement aux cancers du sein, colorectal ou du poumon, qui sont les trois cancers les plus courants chez les femmes. Les femmes atteintes d’un cancer de l’ovaire présentent souvent des symptômes très peu précis qui ne permettent pas toujours de diagnostiquer la maladie immédiatement. Le cancer de l’ovaire est souvent appelé « la maladie sournoise », car il s’avère être un tueur silencieux généralement asymptomatique au stade précoce de la maladie. Au moment où les symptômes se manifestent, le cancer s’est souvent déjà métastasé. À ce stade, il est beaucoup plus difficile de traiter et de vaincre la maladie. Il est important de souligner que si une patiente présente des symptômes persistants inexpliqués, comme des douleurs pelviennes, des douleurs abdominales, une augmentation du tour de taille abdominale, des ballonnements, de la difficulté à s’alimenter, une satiété précoce, une urgence mictionnelle ou une pollakiurie (une envie fréquente d’uriner), elle ne doit pas ignorer ceux-ci et devrait consulter un médecin dans les plus brefs délais.
Q : Comment le soutien communautaire à la recherche aide-t-il les patientes?
« Le soutien communautaire nous permet de travailler ensemble pour faire progresser et améliorer les soins prodigués aux patientes de la région d’Ottawa ».
— Dr Tien Le
R : La mise au point de nouvelles thérapies et l’intégration de nouvelles technologies nécessitent des fonds. La mission de L’Hôpital d’Ottawa a pu compter sur un soutien continu extraordinaire de la part de la communauté. Grâce aux dons reçus, mon service a pu recourir à la chirurgie robotisée pour les patientes en oncologie gynécologique subissant des interventions liées au cancer de l’utérus. Cette technologie permet aux chirurgiens de mieux voir, réduit les risques de complications et fait en sorte que les patientes peuvent se remettre de l’intervention plus rapidement. Cela permet également à L’Hôpital d’Ottawa de réaliser d’importantes économies en raison d’hospitalisations plus courtes et d’une diminution des complications postopératoires devant être gérées. L’argent ainsi économisé peut être utilisé à d’autres fins pour améliorer les soins aux patients. En ce qui concerne le programme de chirurgie robotisée, si ce n’avait été des dons, nous n’aurions pas été en mesure d’intégrer cette technologie pour traiter nos patientes. Il s’agit d’un appareil onéreux. Le soutien communautaire nous permet de travailler ensemble pour faire progresser et améliorer les soins prodigués aux patientes de la région d’Ottawa.
Pourquoi avez-vous choisi de travailler à L’Hôpital d’Ottawa?
R : J’aime beaucoup notre modèle de soins, qui est longitudinal, multidisciplinaire et axé sur le patient. D’un point de vue plus personnel, la camaraderie qui existe entre tous les membres de l’équipe est l’une des raisons pour lesquelles je suis ici depuis 2002. À Ottawa, nous disposons d’une très bonne équipe d’oncologie gynécologique dévouée et déterminée à prendre soin des patientes. Nous travaillons dans un environnement collaboratif et convivial, au sein duquel les médecins, infirmières, pharmaciens et professionnels paramédicaux font tous ce que nous aimons faire et aident les patientes à qui il nous incombe de prodiguer des soins.